L’envers du décor – La otra cara
Le rire des déesses, Ananda Devi
Grasset, 2021
« Depuis la terrasse de la Maison, j’ai tout
vu. J’ai vu Shivnath emmenant Chinti avec la superbe de celui auquel rien ne
saurait être refusé, celui auquel la terre elle-même appartient puisqu’il a
l’appui des dieux, celui devant lequel tant de gens se prosternent qu’il prend
leur adoration pour son dû. » Ananda Devi dresse ici le portrait exact de
ceux qui détiennent le pouvoir, soit pour des raisons économiques ou politiques,
soit pour des raisons soi-disant spirituelles, en Inde, dans ce début du XXIe
siècle. En Inde aussi bien qu’ailleurs.
Le roman commence dans la Ruelle où habitent
les prostitués les plus misérables et les « hijras », ces femmes nées
dans un corps d’homme, d’une grande ville indienne.
Ananda Devi nous dépeint ce décor sinistre
avec le talent d’un Zola de ce siècle.
« Dans
cette Ruelle aux flaques d’eau croupies, jamais évacuées, parmi la mousse qui
tapisse les murs et les ordures entassées dans les recoins, elles ressemblent,
de loin, à des étoiles colorées. Des éclats de verre, de rire, qui captent les
rares lumières. Mais allons plus près, plus près : dans ces corps bariolés
de jaune safran, d’orange cuivré, de vert limon s’est installée la plus
parfaite obscurité. L’espoir s’y réfugie pour mourir. »
Veena, l’une de ces femmes que le destin a
poussée dans la Ruelle, est une femme révoltée. Elle a une enfant, fruit d’un
viol, non désirée, à tel point qu’elle ne lui a jamais donné de nom.
« …Veena
n’a jamais éprouvé le besoin de lui en donner un, espérant que cette absence
d’identité la ferait vite disparaître. Mais l’enfant a résisté, tenace comme
toutes les mauvaises herbes. »
« Les
fesses de l’homme sont velues, divisées par une raie sombre et rouge. Les
jambes de sa mère, au-dessous, sont des poissons morts. Une chaînette en argent
encercle ses chevilles. Le derrière de l’homme s’élève et se rabaisse en
rythme. Cela fait rire la petite. »
L’écrivaine mauricienne n’y va pas par quatre
chemins dans ses descriptions. Et c’est très bien ainsi.
C’est à ce moment-là que la petite fille
décide de se baptiser elle-même, elle s’appellera Chinti, la fourmi.
« Elle
sera celle qui se glissera dans les interstices, verra tout et ne sera vue de
personne. Elle risquera peut-être d’être écrasée par des pieds trop lourds mais
saura toujours se cacher avant que cela n’arrive et les mordra en retour.
Chinti n’est pas une petite fille mais un insecte aux mandibules puissantes,
aux antennes sensibles, aux pattes agiles. »
S’étant donné un nom, on pourrait dire que l’enfant
acquiert une vraie existence. Elle danse, prend soin d’elle-même, dans la
mesure du possible, elle se lie d’amitié avec Bholi, « qu’on croit idiote
mais qui ne l’est pas, qui garde pour elle ses pensées et ses rêves. » Le
premier grand chagrin de Chinti, son premier drame, sera la mort de Bholi, sa
seule amie.
Et c’est là qu’entre en scène Shivnath, un
homme qui, à priori, n’aurait rien à faire dans cette Ruelle ignoble. Un « swami »,
un homme des dieux. Propre, étincelant même, bien habillé, dans un autre
contexte, ce pourrait être un politicien, une star des réseaux sociaux ou, bien
sûr, un religieux.
Shivnath s’entiche tout d’abord de Veena, si
différente des autres prostitués avec son sourire qui cache tant de rage, jusqu’à
ce qu’il découvre la petite Chinti et qu’il jette son dévolu sur elle.
Tout se précipite, Shivnath réussit à emmener
la petite chez lui, dans son temple clinquant et l’amour maternel que Veena
avait soigneusement annulé dans son cœur, éclate.
Quand le swamy décide de faire consacrer
Chinti fille de la déesse Kali à Bénarès, ville sacrée, ville cimetière
ancestrale, Veena, alliée à Sadhana, une hijra qui est aussi la narratrice du
roman, ainsi qu’à toute une cohorte de femmes révoltées, décident de le suivre et
de mettre fin à ses agissements.
Le rire
des déesses est un roman social à la Hugo, dans lequel
les péripéties nous tiennent en haleine jusqu’à la toute dernière page.
Ananda Devi, avec sa prose flamboyante et
engagée, excelle dans l’art de la description, aussi bien des personnes que des
endroits. Les pages consacrées à la ville sainte de Bénarès valent, à elles
seules, le détour.
Un roman magnifique qui nous présente l’envers
du décor d’une Inde réelle, intolérante et patriarcale.
« Desde la terraza de la Casa, vi todo. Vi a
Shivnath llevando a Chinti con la soberbia de aquel a quien nada puede ser
negado, aquel a quien la misma tierra pertenece ya que cuenta con el apoyo de
los dioses, aquel ante quien tanta gente se prosterna que toma su adoración
como algo que le deben.» Ananda Devi hace aquí el retrato exacto de aquellos
que tienen el poder, ya sea por razones económicas o políticas, ya sea por
razones aparentemente espirituales, en la India, en este comienzo de siglo XXI.
En la India como en otros lados.
La novela
comienza en la Callejuela donde habitan las prostitutas más miserables y las « hijras »,
esas mujeres nacidas en un cuerpo de hombre, de una gran ciudad india.
Ananda Devi
nos pinta este decorado siniestro con el talento de un Zola de este siglo.
« En esta
Callejuela con charcos de agua podrida, nunca evacuados, entre los musgos que
tapizan las paredes y la basura apilada en los rincones, ellas se parecen, de
lejos, a estrellas coloridas. Pedazos de vidrio, de risa, que captan las pocas
luces. Pero vamos más cerca, en esos cuerpos coloreados de amarillo azafrán, de
naranja cobrizo, de verde limón, se ha instalado la más perfecta oscuridad. La
esperanza se refugia allí para morir.»
Veena, una
de las mujeres a quien el destino llevó a la Callejuela, es una mujer rebelde.
Tiene una hija, fruto de una violación, no deseada, a tal punto que nunca le
puso un nombre.
«…Veena nunca
sintió la necesidad de darle uno, esperando que esta ausencia de identidad la
hiciera pronto desaparecer. Pero la niña resistió, tenaz como todas las malas
hierbas.»
Un día, la
pequeña descubre una hendidura en el tabique que la separa del lugar donde su
madre ejerce su comercio. Pega en ella sus ojos.
« Las
nalgas del hombre son peludas, divididas por una raya oscura y roja. Las
piernas de su madre, por debajo, son peces muertos. Una cadenita de plata rodea
sus tobillos. El trasero del hombre sube y baja rítmicamente. Eso hace reir a
la pequeña.»
La
escritora mauriciana no se anda con vueltas en sus descripciones. Y está muy
bien.
« Ella será la que se deslizará en los
intersticios, verá todo y no será vista por nadie. Correrá quizás el riesgo de
ser aplastada por pies demasiado pesados pero siempre sabrá esconderse antes de
que esto ocurra y como respuesta los morderá. Chinti no es una nena sino un
insecto de mandíbulas poderosas, de antenas sensibles, de patas ágiles.»
Habiéndose
dado un nombre, se podría decir que la niña adquiere una verdadera existencia. Baila,
se cuida a si misma, en la medida de lo posible, se hace amiga de Bholi, « que creen idiota pero que no lo es, que
guarda para ella sus pensamientos y sus sueños.» La primera gran tristeza
de Chinti, su primer drama, será la muerte de Bholi, su única amiga.
Y es allí
que entra en escena Shivnath, un hombre que, a priori, no tendría nada que
hacer en esa Callejuela inmunda. Un “swami”, un hombre de los dioses. Limpio,
hasta brillante, bien vestido, en otro contexto podría ser un político, una
estrella de las redes sociales, o, por supuesto, un religioso.
Shivnath se
encapricha primero con Veena, tan diferente de las otras prostitutas con su
sonrisa que esconde tanta rabia, hasta que descubre a la pequeña Chinti y pone
su mira en ella.
Todo se
precipita. Shivnah logra llevarse con él a la pequeña, a su templo ostentoso y
el amor materno que Veena había cuidadosamente anulado en su corazón, revienta.
Cuando el
swamy decide hacer consagrar a Chinti como hija de la diosa Kali en Benarés,
ciudad sagrada, ciudad cementerio ancestral, Veena, aliada a Sadhana, una hijra
que es también la narradora de la novela, así como toda una cohorte de mujeres
rebeldes, deciden seguirlo y poner fin a sus acciones.
La risa de
las diosas es una novela social a la Victor Hugo, en la que las peripecias nos
mantienen sin aliento hasta la última hoja.
Ananda
Devi, con su prosa colorida y comprometida, se destaca en el arte de la
descripción, tanto de personas como de lugares. Las páginas consagradas a la
ciudad santa de Benarés valen, por si solas, ser leídas.
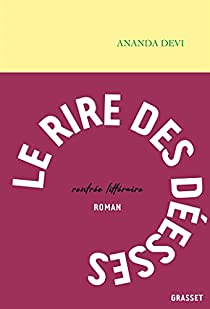






Commentaires
Enregistrer un commentaire