FICHES DE LECTURE – FICHAS DE LECTURA Littérature africaine : briser les tabous – Literatura africana : romper los tabúes
De purs hommes, Mohamed Mnougar Sarr, Philippe Rey, 2018
Les Impatientes, Djaily Amadou Amal, Emmanuelle Collas, 2020
Deux romanciers, et ce ne sont pas les seuls, osent briser des tabous ancrés solidement dans la culture africaine. Mohamed Mbougar Sarr est sénégalais, avec son troisième roman, De purs hommes, il s’attaque à l’un des interdits les plus tenaces des pays africains, l’homosexualité. Djaïli Amadou Amal, autrice camerounaise, nous fait partager, dans Les Impatientes, le destin des jeunes femmes de son pays mariées de force.
« Mais je ne le pouvais pas. Je ne le peux
pas, papa. Même si j’avais l’impression que ce n’était pas de ma vie qu’il
était question, les actes qu’on rapportait étaient les miens. Il fallait que je
les assume. Factuellement, la rumeur avait raison : je m’étais plusieurs
fois recueilli sur la tombe d’Amadou après ma première rencontre avec sa mère,
j’avais passé une soirée avec le góor-jigéen le plus réputé du pays et j’avais
enseigné Verlaine à l’université. La rumeur rapportait donc des faits exacts,
mais leur interprétation, leur signification, les conséquences et conclusions
qu’elle en tirait ne disaient pas la vérité. Elle touchait à la vérité
factuelle, mais manquait totalement la dimension métaphysique. Pourtant,
comment l’expliquer à mon père et Adja Mbène sans donner raison à la
rumeur ? Comment l’expliquer sans aggraver mon cas ?
Adja Mbène, elle, aurait peut-être pu comprendre. Elle
était plus patiente et avait plus d’empathie que mon père. Mais comprendre
quoi ? Que je n’étais pas un góor-jigéen, comme je n’étais pas l’amant
d’Amadou, l’élève de Samba Awa, l’agent de la propagande gay à travers la
poésie de Verlaine ? Était-ce tout ce qu’il y avait à dire pour être
innocent ? Mon humanité se jouait-elle là, dans la preuve que je devais
apporter de mon non-être homosexuel ? Du reste, comment apporter cette
preuve ? Ma parole suffirait peut-être à mon père et à Adja Mbène ;
mais elle ne pèserait rien contre la rumeur. On ne renonce pas si aisément au
plaisir de colporter sans conséquences un ragot malveillant. Il faut de solides
contre-arguments à une mauvaise rumeur pour qu’elle s’arrête. Je n’en avais
pas. Si on vous déclare : « Il paraît, monsieur, que vous êtes un
pédé patenté », que peut-on répondre ? Sans doute rien. »
Nous entendons ici
la voix de Ndéné Gueye, un jeune professeur de lettres sénégalais qui découvre une vidéo virale où
le cadavre d’un homme est déterré et trainé hors du cimetière par un groupe
d’hommes en colère. Il s’agit du corps d’un góor-jigéen, un homme-femme, un
homosexuel, c’est l’un de ces hommes à qui on refuse une tombe.
À travers les
différents personnages que rencontre Gueye, Rama, sa maîtresse, une femme libre
dans ses choix ; son père, un imam enfermé dans le carcan de ses préceptes
religieux ; la mère du jeune homme expulsé du cimetière ; Awa Samba,
un travesti, figure flamboyante et curieusement intouchable du folklore local,
Mohamed Mbougar Sarr nous présente une société hypocrite retranchée derrière
des traditions, des préjugés et de normes religieuses d’une énorme violence.
Or, bien que De purs hommes pointe les tares de la
société sénégalaise, sa portée n’en est pas moins universelle, les violences
homophobes, aussi bien de la part de certains États que des particuliers, sont aujourd’hui, malheureusement, à l’ordre
du jour.
Mohamed Mbougar
Sarr, un jeune auteur doué d’un grand talent et qui s’est déjà attaqué à des
sujets sensibles, le djihad dans Terre
ceinte et les migrants, avec Silence du Chœur, nous offre ici ce
roman bouleversant, qui n’a rien d’un pamphlet contre l’homophobie, écrit dans
une langue ciselée, précise autant que poétique.
La langue de Djaïli Amadou Amal a, par contre bien
moins de relief, ce qui donne aux Impatientes
un certain parfum de naïveté.
Trois femmes en
sont les protagonistes, toutes trois mariées de force par leur père, toutes
trois appartenant à la classe fortunée du Cameroun, une société où la polygamie
est de mise et où la femme n’a aucun droit et un devoir prioritaire qui se
résume en un mot : « Munyal », la patience. Si ton mari te bat,
te trompe, te viole, munyal, sois patiente, tu n’as sûrement pas fait assez
d’efforts pour lui plaire.
Ramla, pas encore
majeure, a fait des études et voudrais les poursuivre à l’université, elle souhaite,
en outre, épouser le garçon qu’elle aime. Son père en décide autrement et la
marie de force à l’un de ses partenaires en affaires, dont Safira est la
première épouse.
Celle-ci, qui ne
veut pas partager son mari, se ruine en marabouts et autre jeteurs de sorts
afin de se débarrasser de Ramla.
Nous trouvons,
enfin, Hindou, demi-sœur de Ramla, que l’on marie à son cousin Moubarak, un
jeune homme alcoolique, drogué et violent. « Ce n’est pas un viol. C’est une preuve d’amour. On conseilla tout de
même à Moubarak de refréner ses ardeurs vu les points de suture que ma blessure
nécessita », nous dit-elle suite à un accès de violence de son mari.
Toute cette
violence se déroule dans un cadre chatoyant d’étoffes précieuses, de beaux
meubles, de voyages à Paris ou à Dubaï, les Mecques de la société de
consommation.
La patience, pour
ces femmes, cesse d’être une vertu pour devenir un châtiment, une vraie
malédiction. Une malédiction qui perdure, hélas !, grâce à la complicité
des femmes elles-mêmes, prisonnières d’un système patriarcal et inhumain.
Deux livres que je
pense incontournables à un moment de l’histoire où les Droits Humains sont
remis en cause, sont en danger, un peu partout sur la planète, où les idéaux
d’égalité et de solidarité semblent se diluer.
Ce n’est pas que de
l’Afrique dont ils nous parlent, c’est de l’être humain, de sa part d’ombre.
Or, bien qu’un livre, actuellement, puisse difficilement changer la marche du
monde, leur lecture peut nous faire espérer un avenir plus juste.
Dos novelista, y no son los únicos, se atreven
a romper los tabúes anclados sólidamente en la cultura africana.. Mohamed Mbougar Sarr es senegalés, con
su tercera novela, De purs hommes
(Puros hombres), ataca uno de los interdictos más tenaces de los países
africanos, la homosexualidad. Djaïli
Amadou Amal, autora camerunesa, nos hace compartir, en Les Impatientes (Las impacientes), el destino de las jóvenes
mujeres de su país casadas por la fuerza.
« Pero yo no podía. No puedo, papá. Aún si
tenía la impresión de que no se trataba de mi vida, los actos de los que
hablaban eran los míos. Tenía que asumirlos. Fácticamente, el rumor tenía
razón: varías veces me había recogido ante la tumba de Amadou, después de mi
primer encuentro con su madre, había pasado una tarde con el góor-jigéen más
renombrado del país y había enseñado a Verlaine en la universidad. El rumos
hablaba entonces de hechos exactos, pero su interpretación, su significado, las
consecuencias y conclusiones que sacaba de ello no decían la verdad. Tocaban a
la verdad fáctica, pero carecía totalmente de dimensión metafísica. ¿Cómo
explicarlo, sin embargo, a mi padre y a Adja Mbène sin darle la razón al rumor?
¿Cómo explicarlo sin agravar mi caso?
Adja Mbène quizás habría podido
entenderme. Era más paciente y tenía más empatía que mi padre. ¿Pero entender
qué? Que yo no era un góor-jigéen, como no era el amante de Amadou, el alumno
de Samba Awa, el agente de la propaganda gay por intermedio de la poesía de
Verlaine? ¿Era todo lo que tenía que decir para ser inocente? ¿Mi humanidad se
jugaba en la prueba que debía aportar de mí no ser homosexual? ¿Por otra parte,
como aportar esta prueba? Mi palabra les bastaría quizás a mi padre y a Adja
Mbène; pero no pesaría nada contra el rumor. No se renuncia tan fácilmente al
placer de llevar sin consecuencias un chisme malicioso. Se necesitan sólidos
contra argumentos ante un rumor malvado para que se
detenga. Yo no los tenía. Si le declaran a uno: « Parece, señor, que usted es un marica patentado”, ¿qué puede
uno contestar? Nada, sin dudas.»
Oímos aquí la voz de Ndéné Gueye, un joven
profesor de letras senegalés que descubre un video viral en que el cadáver de
un hombre es desterrado y arrastrado fuera del cementerio por un grupo de
hombres iracundos. Se trata del cuerpo de un góor-jigéen, un hombre-mujer, un
homosexual, es uno de esos hombres a quien le niegan una tumba.
Por intermedio de los diferentes personajes que
encuentra Gueye, Rama, sa amante, una mujer libre en sus elecciones; su padre,
un imam encerrado en la armadura de sus preceptos religiosos; la madre del
joven expulsado del cementerio; Awa Samba, un travesti, figura flamígera y
curiosamente intocable del folklore loca, Mohamed Mbougar Sarr nos presenta una
sociedad hipócrita encerrada detrás de sus tradiciones, de los prejuicios y de
normas religiosas de una enorme violencia.
Por más que De purs hommes, empero, apunte
las taras de la sociedad senegalesa, su alcance no es menos universal, las
violencias homofóbicas, tanto de parte de ciertos estados como de los
particulares, están hoy, desgraciadamente, a la orden del día.
Mohamed Mbougar Sarr, un joven autor dotado de
un gran talento y que ya se abocó a temas sensibles, el djihad en Terre ceinte y los migrantes con Silence du Chœur, nos ofrece aquí esta
novela conmovedora que no tiene nada de un panfleto contra la homofobia, escrita en una lengua cincelada, precisa tanto
como poética.
La lengua de Djaïli Amadou Amal
tiene, por lo contrario, mucho menos relieve, lo que da a Les Impatientes
un cierto dejo de ingenuidad.
Tres mujeres son las protagonistas, las tres casadas por la fuerza por
su padre, las tres pertenecientes a la clase afortunada del Camerún, una sociedad
en la que la poligamia está a la orden del día, y donde la mujer no tiene ningún
derecho y un deber prioritario que se resume en una palabra: « Munyal », la paciencia. Si tu marido te
pega, te engaña, te viola, munyal, se paciente, seguramente no hiciste
suficientes esfuerzos para gustarle.
Ramla, que aún no es mayor, estudió y querría
seguir en la universidad, desea, además, casarse con el chico que ama. Su padre
decide otra cosa y la casa por la fuerza con uno de sus socios de negocios, de
quien Safira es la primera esposa.
Esta, que no quiere compartir a su marido, se arruina en marabús y otros
brujos para sacarse de encima a Ramla.
Encontramos, por fin, a Hindou, medio hermana de Ramla, a quien casan
con su primo Moubarak, un joven alcohólico, drogadicto y violento. “No es una violación. Es una prueba de amor. Aconsejaron
de todos modos a Moubarak que refrenara sus ardores, en consideración de los
puntos de sutura que necesitó mi herida”, nos dice ella luego de un acceso
de violencia de su marido.
Toda esta violencia se desarrolla en un marco
reluciente de telas preciosas, de bellos muebles, de viajes a París o a Dubái,
las mecas de la sociedad de consumo.
La paciencia, para estas mujeres, deja de ser una virtud para volverse un castigo, una verdadera maldición. Una maldición que desgraciadamente perdura, gracias a la complicidad de las mismas mujeres, prisiones del sistema patriarcal e inhumano.
Dos libros que considero inevitables en un
momento de la historia en que los Derechos Humanos son cuestionados, están en
peligro, en muchos lados del planeta, en que los ideales de igualdad y de
solidaridad parecen diluirse.
No sólo nos hablan de África, nos hablan del ser humano, de su lado
oscuro. Sin embargo, aunque un libro, actualmente, pueda difícilmente cambiar
la marcha del mundo, su lectura puede hacernos esperar un porvenir más justo.
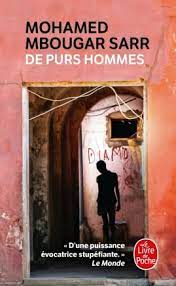






Commentaires
Enregistrer un commentaire